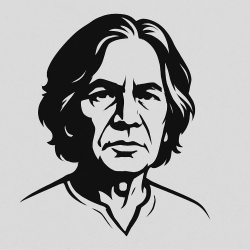« Je n’ai pas d’enseignement, et il n’y en aura jamais. « Enseigner » n’est pas le mot qui convient. Un enseignement implique une méthode ou un système, une technique ou un nouveau mode de pensée à appliquer pour provoquer une transformation dans votre mode de vie. Ce que je dis est en dehors du domaine de l’enseignabilité ; c’est simplement une description de la façon dont je fonctionne. C’est juste une description de l’état naturel de l’homme – c’est la façon dont vous, dépouillés des machinations de la pensée, fonctionnez aussi. » U.G
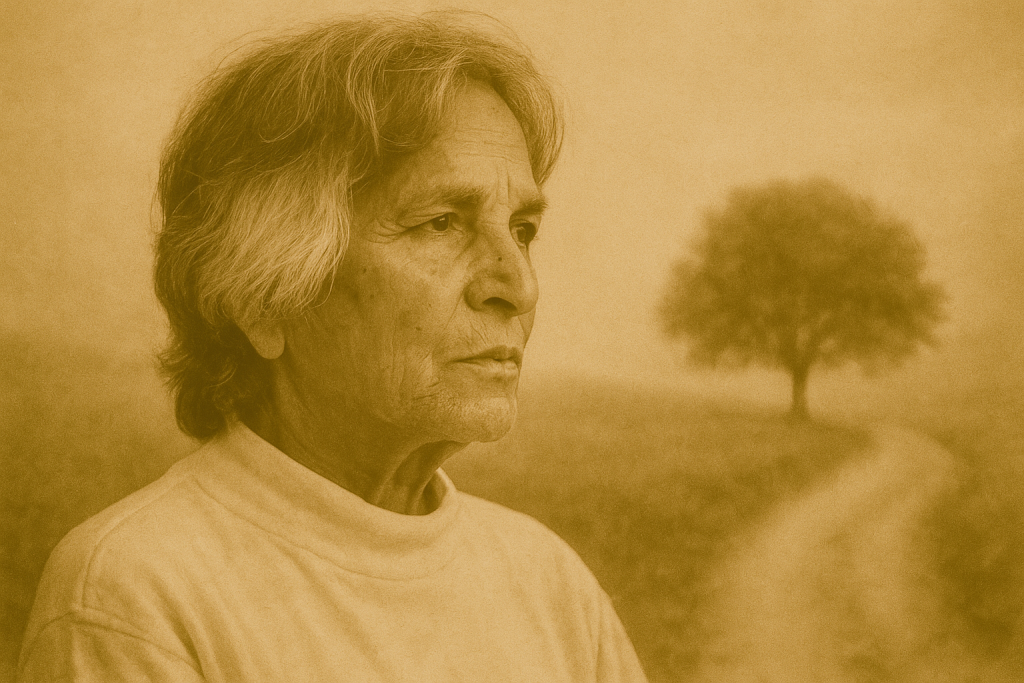
U.G. Krishnamurti (1918-2007) a vécu une transformation totale en 1967. Selon un de ses biographes (Mukunda Rao) avec qui nous sommes en accord, son anti-enseignement est passé par trois phases : « Nous pouvons discerner approximativement trois phases dans la vie d’U.G. et son anti-enseignement.
La première a duré de 1967 jusqu’à la fin des années 70, où son approche peut être qualifiée de cru, douce, tendre et obligeante. À cette époque, U.G. parlait avec approbation, bien que prudemment, d’autres sages et de leurs enseignements, ainsi que de certains textes religieux. C’était, en un sens, un U.G. différent, ouvert et persuasif, qui emmenait ou conduisait ses auditeurs, avec tant de sympathie et de sollicitude, dans un voyage d’exploration du fonctionnement de l’esprit et du corps. Il leur faisait remarquer la non-pertinence des méthodes et des techniques de réalisation de soi, l’état non naturel et ses problèmes, l’état naturel en tant qu’état physiologique de l’être et comment il pouvait avoir un impact ou changer la conscience du monde, etc. (Lire le livre édité par Mukunda Rao The biology of enlightenment)
Pendant la deuxième phase, dans les années 1980 et 1990, il a eu l’air d’un sage enragé. Ses paroles étaient profondes, explosives et cathartiques. Il était comme un feu qui réduisait tout en cendres pour qu’un nouveau départ puisse être pris, sans la moindre trace de tristesse. C’est aussi à cette époque qu’il est devenu un personnage public en donnant des interviews à la télévision et des conférences à la radio afin de toucher les gens du monde entier. Tous les grands récits et symboles des diverses religions et cultures, idéologies et philosophies étaient subvertis ou rejetés comme autant de déchets. Il n’y avait rien de sacré ou de sacro-saint, rien d’indiscutable et d’incontestable : la subversion était la voie, puis la subversion aussi était subvertie et démolie. Il était l’être primordial, le membre non converti de la race humaine, faisant sauter tous les cadres de pensée, remettant en question le fondement même de la culture humaine. Pendant cette phase, les gens l’appelaient, en particulier dans les médias, le sage enragé, un naxalite cosmique, un anti-gourou, etc., et cette image de lui comme sage enragé a été en quelque sorte surestimée et fixée même dans l’esprit des admirateurs d’U.G., sans parler des médias et de ceux qui n’avaient qu’une vague idée de qui il était et de son enseignement. Cela a seulement montré combien il était difficile de comprendre la vérité non duelle qu’il essayait de transmettre, pris dans un mode de pensée et d’être dualiste et marié à un idéal ou à un autre. Comme le Bouddha – qui a fait tomber tous les récits comme de simples constructions mentales et une entrave à l’entrée dans l’état de nirvana – en faisant exploser toutes nos idées et idéaux, il n’a pas seulement arraché le tapis de sous nos pieds, mais il a aussi détruit le sol illusoire sur lequel nous nous tenions. Il ne nous a pas permis de nous accrocher à un quelconque mensonge, car un mensonge est une erreur qui a falsifié nos vies. La vérité, aussi dure, bouleversante et choquante soit-elle, devait nous être apportée. (Presque tous les livres publiés des entretiens d’U.G. viennent de cette période).
Les dix dernières années avant la mort d’U.G. peuvent être qualifiées de phase d’enjouement et de rire. Puisque toutes les expressions étaient fausses, même dire que quelque chose était faux était faux, il n’y avait que le rejet total et complet, et il y avait le rire. Il y avait les doux et délicieux rires de Krishna, le buveur de lait, et l’attahasa ou rire apocalyptique de Shiva, le buveur de poison. Cependant, l’essentiel de son approche était toujours le même. Il décrit la façon dont nous fonctionnons à l’état non naturel, pris dans un monde d’opposés, luttant constamment pour devenir autre chose que ce que nous sommes, et à la recherche de dieux et de buts inexistants. Comment nous pensons et fonctionnons tous dans une sphère de pensée, tout comme nous partageons tous la même atmosphère pour respirer. Comment et pourquoi le soi, qui est de nature autoprotectrice et fasciste, n’est pas l’instrument qui nous aide à vivre en harmonie avec la vie qui nous entoure. Préférant le terme état naturel à celui d’illumination, il a insisté sur le fait que toute transformation qu’il avait subie était à l’intérieur de la structure du corps humain et pas du tout dans l’esprit. Et il a décrit l’état naturel comme un état d’être physique et physiologique pur et simple. C’est l’état de conscience primordiale sans primitivisme, ou l’état de conscience indivise, où tous les désirs et la peur, et la recherche du bonheur et du plaisir, de Dieu et de la vérité, ont pris fin. C’est un état acausal de non-connaissance. Si il a marqué la continuité créative des traditions d’éveil du Bouddha, des Upanishads et des sages indiens ultérieurs, U.G. a aussi marqué une rupture radicale avec les traditions d’éveil dans la manière dont il a dépsychologisé et démystifié la notion d’éveil, et l’a redéfinie comme l’état naturel en termes physiques et physiologiques. Plus important encore, en supprimant tous les grands récits et épistémologies, il nous a offert non seulement une libération de la tyrannie des symboles et des idées sacrées, des dieux et des buts, mais aussi un avant-goût de ce vaste vide. »
U.G. n’était pas parent de l’autre Krishnamurti, bien plus connu. Nombreux admirateurs des deux Krishnamurti croient que les deux enseignements sont très différents. Mais à notre avis leurs critiques de la société et essentiellement du fonctionnement du moi et de ses fuites sont exactement les mêmes. Avec quelques expressions différentes et l’insistance d’U.G. sur la transformation physiologique corporelle (mais ce n’est plus le corps que nous imaginons connaître) et ses critiques répétés envers l’autre Krishnamurti, cette similitude est brouillée. Enfin du fait que nombreuses citations d’U.G. sont produites abruptement sans explications, laisse croire qu’elles sont plus révolutionnaires que les dire de Krishnamurti qui lui prenait soin d’expliquer les mécanismes du moi.
Une remarque finale sur la communauté des admirateurs d’U.G. : À part quelques personnes qui ont travaillé sur eux-mêmes les conséquences des dire d’U.G., comme Mukunda Rao par exemple, beaucoup tombent dans un cynisme des plus égoïstes. Ces admirateurs, par manque de maturité intérieure, ne savent plus écouter qui que ce soit : Que quelqu’un ose vivre ou dire quelque chose, c’est assurément son égo. Cette situation est regrettable.
Extraits de Rao, Mukunda. Belief and Beyond : Adventures in Consciousness from the Upanishads to Modern Times . HarperCollins Publishers India.
Traduction libre