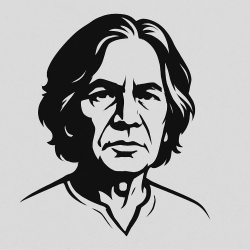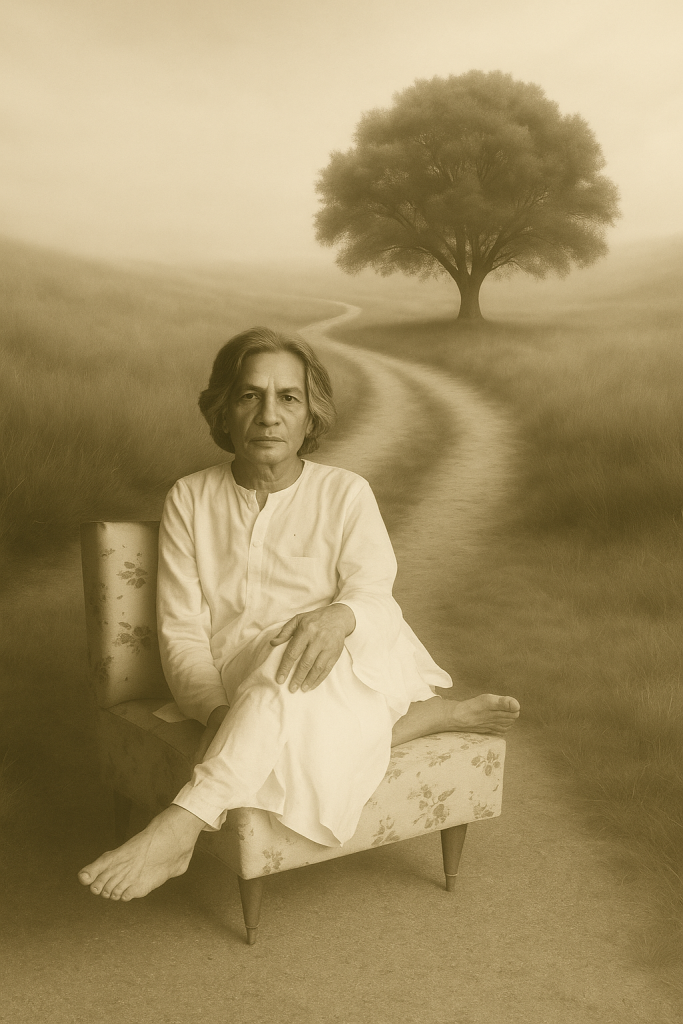
À la source de mon changement de paradigme
Lire U.G. Krishnamurti a littéralement bouleversé ma façon de penser et plus exactement, a commencé à fissurer le socle même sur lequel ma pensée reposait depuis de longues années.
Il ne s’agit pas d’un simple changement d’opinion, ni d’un déplacement idéologique, encore moins d’une nouvelle croyance venue remplacer les anciennes.
Ce qui est touché ici est beaucoup plus radical : la structure même du mental, son fonctionnement automatique, sa prétention à comprendre, à contrôler, à se projeter vers un avenir meilleur.
Les propos d’UG ont ceci de singulier qu’ils ne cherchent jamais à convaincre.
Ils ne proposent aucun chemin, aucune méthode, aucune promesse de salut. Et pourtant, ils s’imposent avec une force presque brutale. Une force qui ne vient pas de l’argumentation, mais de l’évidence. Une évidence dérangeante, nue, impossible à enjoliver.
Lorsqu’on le lit réellement, c’est-à-dire sans chercher à interpréter, sans tenter de récupérer ses mots pour nourrir une quête spirituelle, on se rend compte que ce qu’il dit est simplement indiscutable. Non pas parce qu’il aurait raison contre d’autres, mais parce que ses paroles pointent directement vers ce qui est là, sous nos yeux, depuis toujours.
Et c’est précisément pour cette raison qu’on est, d’une certaine manière, obligé de les accepter. Non pas moralement, ni intellectuellement, mais parce qu’il devient impossible de continuer à faire semblant. Impossible de continuer à croire que le mental est un outil neutre, qu’il nous conduit vers la liberté, qu’il finira un jour par résoudre le problème fondamental de l’existence. UG met à nu le mécanisme même par lequel nous nous illusionnons et une fois que ce mécanisme est vu, il n’est plus possible de l’ignorer totalement.
Cependant, il serait faux de dire que tout ce qu’il dit est immédiatement compréhensible ou acceptable. Certains de ses propos heurtent, choquent, irritent profondément. Non pas parce qu’ils seraient faux, excessifs ou provocateurs par goût du scandale, mais parce qu’ils vont directement à l’encontre de ce à quoi le mental s’accroche pour survivre. Le mental rejette ce qui menace sa continuité. Il rejette tout discours qui ne lui laisse aucune porte de sortie, aucun rôle à jouer, aucune possibilité de progression ou d’amélioration.
Ce rejet n’est pas un signe d’erreur dans les paroles d’UG. Il est au contraire un indicateur précieux. Il montre exactement là où le conditionnement est le plus enraciné. Là où l’identification est la plus forte. Là où la peur de disparaître, non pas physiquement, mais psychologiquement est la plus vive. UG ne cherche pas à rassurer cette peur. Il la laisse apparaître dans toute sa nudité.
C’est pourquoi il est illusoire de croire que l’on peut “comprendre” UG simplement par curiosité intellectuelle ou par intérêt philosophique. Tant que tout va relativement bien, tant que la vie semble encore fonctionner selon des schémas acceptables, ses paroles restent abstraites, excessives, voire absurdes. Elles peuvent être lues, commentées, discutées… mais elles ne touchent pas vraiment.
Pour que quelque chose s’ouvre ou plutôt pour que quelque chose cède, il faut une certitude intime, presque viscérale, que quelque chose cloche. Que malgré les efforts, les recherches, les thérapies, les croyances, les expériences spirituelles, rien ne s’est réellement résolu. Que “ça ne tourne pas rond”. Que le malaise n’est pas accidentel, mais structurel. Qu’il ne s’agit pas d’un problème personnel à corriger, mais d’un fonctionnement global profondément défaillant.
Lorsque cette certitude est là, même confusément, les mots d’UG résonnent différemment. Ils cessent d’être une attaque ou une provocation. Ils deviennent une description clinique, froide, sans compassion ni cruauté. Une mise à nu de l’impasse dans laquelle l’humanité s’agite depuis des millénaires. Et paradoxalement, c’est cette absence totale de solution qui soulage. Parce qu’elle met fin à l’espoir et donc à la frustration permanente qu’il engendre.
Lire UG, dans ces conditions, n’apporte pas de réconfort. Cela enlève plutôt les béquilles. Cela retire les illusions les plus chères : celle du progrès intérieur, de la transformation, de l’éveil futur. Mais en même temps, cela installe une honnêteté radicale, presque violente, face à ce qui est. Et cette honnêteté-là, aussi inconfortable soit-elle, est peut-être la seule chose qui ne soit pas fabriquée par le mental.
Ce n’est donc pas un enseignement. Ce n’est pas un chemin. Ce n’est pas une philosophie à adopter. C’est une confrontation. Et elle n’est possible que pour celui qui sait déjà, au fond de lui, que continuer comme avant n’est plus une option.
Vous trouverez des lectures qui bousculent un peu… et d’autres qui renversent tout.
Le jour où je suis tombé sur ce passage de Mind is a Myth d’ U.G. Krishnamurti, quelque chose s’est fissuré. Pas un petit éclair de compréhension douce, mais un choc frontal avec une évidence : et si tout ce que j’avais cru sur la spiritualité, la bonté, le « devoir être » n’était qu’un ajout artificiel, une violence subtile faite à mon corps ?
Comme je l’ai déjà dit, U.G. ne cherche pas à rassurer. Il ne vend pas un chemin vers un idéal. Il montre, sans ménagement, que cette quête même « vouloir être « meilleur », plus aimant, plus compatissant est un effort inutile qui ne fait qu’ajouter de la tension à ce que nous sommes déjà.
Ce texte m’a fait comprendre que la véritable libération ne passe pas par l’ajout de valeurs, de croyances, de techniques ou de vertus, mais par la fin de cette poursuite.
Ce fut le point de bascule : l’instant où le décor s’est effondré, où les injonctions spirituelles ont perdu leur autorité, et où j’ai commencé à voir la vie sans filtre.
C’est à partir de là que Pas de chemin a pris forme : un espace pour explorer, non pas comment devenir quelqu’un d’autre, mais comment voir qu’il n’y a rien à atteindre.
« Le corps ne s’intéresse absolument pas aux questions psychologiques ou spirituelles. Vos expériences spirituelles tant louées n’ont aucune valeur pour l’organisme. En réalité, elles sont douloureuses pour le corps. L’amour, la compassion, l’ahimsa, la compréhension, la béatitude — toutes ces choses que la religion et la psychologie ont placées devant l’homme — ne font qu’ajouter à la tension du corps. Toutes les cultures, qu’elles soient orientales ou occidentales, ont créé cette situation déséquilibrée pour l’humanité et ont transformé l’homme en un individu névrosé. Au lieu d’être ce que vous êtes — méchant — vous poursuivez l’opposé fictif qu’on vous a mis devant — la gentillesse. Mettre l’accent sur ce que nous DEVONS être ne fait qu’engendrer une tension, donnant plus d’élan à ce que nous sommes déjà en réalité. U.G. »
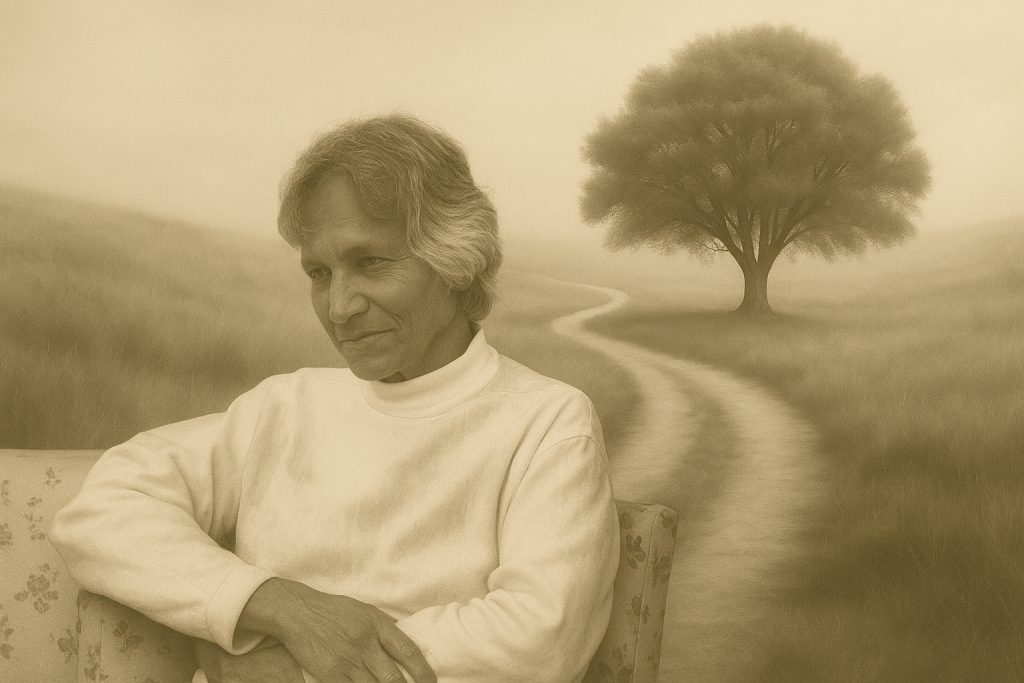
Objectivement — en mettant de côté l’adhésion ou le rejet — ce texte d’U.G. Krishnamurti est radical et cohérent dans sa logique interne, mais aussi délibérément provocateur.
Voici comment je l’analyse :
– Point central :
U.G. affirme que les idéaux spirituels et moraux ne sont pas neutres, mais intrusifs et violents pour l’organisme.
Selon lui, l’effort constant pour devenir « meilleur » crée une tension psychophysique, parce qu’il oppose ce que nous sommes à ce que nous devrions être.
– Rupture avec la tradition :
Dans la plupart des philosophies et religions, on considère que l’être humain doit évoluer vers un idéal (amour, compassion, paix intérieure).
U.G. inverse cette idée : poursuivre l’idéal, c’est déjà se couper de soi.
– Provocation assumée :
Il ose dire « au lieu d’être ce que vous êtes — méchant — vous poursuivez l’opposé fictif — la gentillesse ».
Ce n’est pas une apologie de la méchanceté, mais un refus de l’hypocrisie de l’idéal imposé.
– Conséquence logique :
En supprimant l’idéal, on enlève aussi la lutte intérieure.
Ce n’est pas une recette de bonheur, mais un constat : le corps fonctionne mieux sans surcharge de concepts sur ce qu’il devrait être.
– Il attaque la racine, pas les branches
Beaucoup de discours spirituels ou de développement personnel critiquent certaines attitudes (l’ego, la colère, l’attachement) mais proposent ensuite un « chemin » pour les transformer.
U.G. coupe directement à la base : c’est le chemin lui-même qui est le problème.
Cela provoque un effet de sidération mentale : si le moyen de guérir est la cause de la maladie, alors toute la structure de croyance vacille.
– Il brise la promesse d’un futur meilleur
Le cerveau humain fonctionne souvent avec un « contrat tacite » : Si je fais des efforts aujourd’hui, je deviendrai quelqu’un de meilleur demain.
Ce texte refuse ce contrat et dit : il n’y a pas de “demain” où vous serez meilleur.
Psychologiquement, c’est déstabilisant… et libérateur, car cela retire d’un coup le poids de la dette morale envers un idéal.
– Il valide ce que nous ressentons en secret
Beaucoup de gens, malgré leurs efforts, ressentent au fond d’eux : « Je n’y arrive pas. » – « Je ne suis pas aussi aimant ou compatissant qu’on me dit de l’être. » – « Ça me fatigue. »
Ce texte légitime cette fatigue et cette résistance, en disant : c’est normal, c’est le corps qui rejette la surcharge.
Cette reconnaissance est un soulagement, presque une permission d’arrêter de lutter.
– Il fait tomber la façade
En disant : « Au lieu d’être ce que vous êtes — méchant — vous poursuivez la gentillesse », U.G. force à regarder l’ombre directement.
Ce n’est pas pour l’éradiquer, mais pour cesser de se définir par son contraire idéalisé.
Sur le plan psychologique, cela ouvre une porte vers l’acceptation radicale de ce qui est.
– Il ne propose pas de substitut
La plupart des critiques finissent par offrir une nouvelle méthode, un nouveau “meilleur chemin”.
U.G. ne laisse pas cette échappatoire.
Cela crée un vide — inconfortable, mais fertile — où la pensée cesse de tourner autour de la question « comment devenir ? » et commence à voir « ce qui est » sans but caché.
En résumé : ce texte est puissant parce qu’il enlève d’un seul coup la béquille psychologique de l’idéal, et qu’il ne la remplace par rien. Ce vide peut d’abord sembler vertigineux, mais c’est aussi là que s’ouvre un espace de liberté réelle, non programmée.