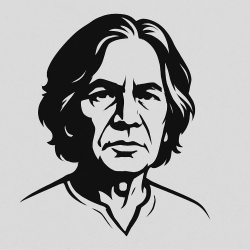Voici, très probablement, ce qu’il aurait dit à Viktor Frankl
« Tu vois, Viktor, tu es passé à travers un enfer — le plus grand que l’homme puisse imaginer. Et ton corps, d’une manière ou d’une autre, a survécu. Mais ce que tu en as tiré n’est qu’une idée, une interprétation. Tu as donné à cette survie un sens, un but, une valeur — parce que l’esprit humain ne peut pas supporter le vide.
Tu dis que l’homme a besoin d’un “pourquoi” pour survivre. Mais regarde bien : c’est précisément cette recherche d’un “pourquoi” qui est la racine de toute misère humaine. L’homme préfère inventer un sens plutôt que de faire face au fait qu’il n’y en a aucun.
Le sens, Viktor, est une invention de la pensée. Ce n’est pas quelque chose que tu découvres — c’est quelque chose que tu crées pour te rassurer. Et cette création, aussi belle ou compatissante soit-elle, est encore une fuite devant la réalité brute : la vie n’a pas besoin de sens pour exister.
Tu dis qu’on peut tout enlever à un homme sauf la liberté de choisir son attitude. Mais ce “choix”, lui aussi, est une illusion. Il n’y a pas de choix. Il n’y a que des réactions, conditionnées par des milliers d’années d’instinct, de culture, de peur.
Tu n’as pas “choisi” de survivre, Viktor. La vie en toi a continué — comme un arbre qui pousse même dans les ruines. Elle n’a pas eu besoin d’un “pourquoi”. Tu lui as donné un sens après coup, parce que ton mental ne supporte pas l’absence de cause, de finalité.
Tu as transformé ta souffrance en une idée consolatrice : que l’homme peut triompher du désespoir en trouvant un sens. Mais le désespoir ne peut être transcendé que lorsqu’il est vu pour ce qu’il est — sans le travestir en leçon, sans y projeter une signification.
Ta “victoire” sur la mort est une invention poétique. Il n’y a pas de victoire, pas de défaite, pas de survivant, pas de victime. Il y a seulement la vie — indifférente, sans centre, sans témoin.
Et pourtant, je ne te blâme pas. Car l’homme doit inventer des sens pour continuer à fonctionner. Sans cette illusion, le système s’effondrerait. Mais sache simplement que c’est un mensonge nécessaire, pas une vérité.
Tu as offert de l’espoir à des millions de gens. Moi, je n’ai rien à offrir.
Parce que là où tu vois un sens à trouver, je vois seulement la fin du chercheur. »
En résumé, UG ne nierait pas la grandeur humaine du geste de Frankl, ni son courage — mais il le verrait comme une expression de la peur fondamentale du vide, de cette incapacité du mental à rester avec “ce qui est”, sans y apposer une histoire.
Pour UG, la survie de Frankl n’est pas un triomphe du sens — mais un événement naturel, sans signification. C’est le mental qui, plus tard, a peint autour de ce fait brut une fresque de signification pour se donner l’impression d’avoir compris.
Voici ce dialogue imaginaire entre Viktor Frankl et U.G. Krishnamurti, tel qu’il aurait pu se dérouler, quelque part dans un salon tranquille, bien des années après la guerre — deux hommes qui ont traversé la souffrance, mais qui l’ont comprise de deux façons radicalement opposées.
Dialogue : “Le sens ou la fin du chercheur”
Frankl :
J’ai vu des hommes mourir, U.G. Pas seulement à cause de la faim, mais parce qu’ils avaient perdu leur raison de vivre.
Quand un homme perd son pourquoi, son corps s’éteint.
C’est ce que j’ai découvert dans les camps.
L’homme peut supporter presque tout… s’il sait pourquoi.
U.G. :
Le “pourquoi”, Viktor, est la maladie.
Ce n’est pas le remède.
C’est ce besoin même de sens qui ronge l’homme de l’intérieur.
L’esprit humain ne supporte pas le vide, alors il invente une raison pour continuer — et il appelle cela “espoir”.
Frankl :
Mais sans espoir, sans direction, comment vivre ?
Dans le désespoir absolu, c’est précisément le sens qui m’a maintenu en vie.
La conviction qu’il me restait quelque chose à accomplir.
U.G. :
Tu n’as rien “accompli”, Viktor.
La vie t’a traversé, voilà tout.
Ce n’est pas toi qui as choisi de survivre.
Tu respires parce que le corps le fait — pas parce qu’un sens l’y pousse.
C’est une mécanique, pas un miracle.
Frankl :
Tu sembles nier ce que j’ai vécu.
J’ai senti dans ma chair que l’homme peut transcender les pires circonstances en trouvant une signification à sa souffrance.
U.G. :
Tu n’as pas transcendé ta souffrance, tu l’as transformée en concept.
Tu l’as rendue utile, noble, supportable.
Mais la souffrance n’a pas de sens, Viktor.
Elle ne mène nulle part.
Quand tu lui donnes un sens, tu l’embellis, tu la fuis.
Tu l’enrobes d’un parfum spirituel pour ne pas sentir son odeur brute.
Frankl :
Alors tu dis qu’il ne reste rien ?
Que la vie est vide, absurde, dénuée de toute signification ?
U.G. :
Je ne dis pas qu’elle est “vide” — même ça, c’est une idée.
Je dis simplement : elle est.
Ni sens, ni non-sens.
Le vent souffle, le cœur bat, la douleur passe.
Tout cela se produit sans centre, sans observateur.
Mais toi, tu veux toujours un témoin, un but, une morale.
Frankl :
Et sans cela, que devient l’homme ?
Une machine biologique, sans orientation, sans valeur ?
U.G. :
Exactement. Et c’est cela la libération.
Quand il voit qu’il n’a jamais été “quelqu’un”, qu’il n’y a rien à sauver, rien à accomplir — alors tout ce poids tombe.
Ce que tu appelles “orientation” n’est qu’une fuite organisée.
Tu appelles ça thérapie, moi j’appelle ça prolongation du rêve.
Frankl :
Mais si je dis à un homme brisé qu’il n’y a aucun sens, je le condamne au désespoir !
U.G. :
Non. Tu le condamnes à la vérité.
Et le désespoir, s’il est total, s’il n’a plus d’issue — finit par brûler le chercheur lui-même.
Et là, il n’y a plus rien à sauver, ni à comprendre.
Il y a seulement la vie, nue, sans pourquoi.
C’est la seule “guérison” possible, et elle n’a rien à voir avec une méthode.
Frankl :
Alors ma logothérapie n’était qu’une autre illusion ?
U.G. :
Oui. Une illusion belle, humaine, pleine de compassion — mais illusion quand même.
Tu as offert aux gens une raison de continuer.
Moi, je leur enlève toute raison.
Et pourtant, dans ce vide total, la vie continue d’elle-même.
C’est cela, la vraie liberté.
(Silence.)
Frankl :
Peut-être que nos chemins se croisent malgré tout, U.G.
Toi, tu détruis les illusions.
Moi, j’en ai créé une qui sauve.
Et les deux, d’une certaine manière, aident les hommes à vivre.
U.G. (souriant faiblement) :
Oui, Viktor.
Toi, tu leur donnes un sens pour supporter la vie.
Moi, je leur enlève tout sens pour qu’ils cessent enfin de la supporter.
Le sens est la maladie
1. Le mythe du “pourquoi”
L’homme ne supporte pas le vide.
Quand il ne comprend pas ce qui lui arrive, il invente une raison.
C’est sa façon de ne pas sombrer.
Dans les camps de la mort, Viktor Frankl a vu des hommes mourir parce qu’ils avaient perdu leur “pourquoi”.
Il en a conclu que trouver un sens pouvait sauver la vie.
Et il avait raison — du point de vue de la survie.
Mais ce “pourquoi” est aussi le poison.
Car tant qu’il existe, la recherche continue.
Et tant que la recherche continue, la souffrance n’a pas de fin.
2. L’esprit ne peut pas supporter le vide
Le mental préfère un mensonge réconfortant à une vérité sans issue.
Il préfère la signification à la pure existence.
Il dit : “Si je souffre, c’est pour quelque chose.”
Mais la souffrance n’a pas de but. Elle est.
Comme la pluie, le feu ou la mort.
Tout sens que nous lui attribuons n’est qu’une décoration du désespoir.
Une fuite.
Un parfum pour masquer l’odeur du néant.
3. La survie n’est pas un miracle
Frankl dit : “Celui qui a un pourquoi peut supporter presque tous les comment.”
U.G. répondrait : “Celui qui ne cherche plus aucun pourquoi n’a plus rien à supporter.”
Tu n’as pas besoin d’une raison pour respirer.
Le cœur bat sans motif.
La vie n’a pas besoin de toi pour continuer.
C’est seulement la pensée qui réclame une explication.
4. La dernière illusion : la liberté de choisir
Frankl parle d’une “dernière liberté” :
celle de choisir son attitude face à n’importe quelle situation.
Mais pour U.G., ce choix est une illusion.
Il n’y a pas de centre qui choisit, pas d’âme qui décide.
Il n’y a que des réactions.
Le corps agit, la pensée interprète — et l’ego dit “c’est moi”.
Ce que Frankl appelle “liberté intérieure” n’est qu’une réorganisation subtile de la prison.
5. La fin du chercheur
Quand le besoin de sens s’effondre, il ne reste rien — rien à comprendre, rien à accomplir, rien à sauver.
Et c’est là que quelque chose d’extraordinaire se produit : le désespoir total se dissout de lui-même.
Il ne reste pas la paix, ni la joie, ni l’espoir.
Il reste la vie, nue, indifférente, auto-suffisante.
Le battement du monde sans interprète.
6. U.G. : “Tu offres une raison de vivre, moi j’enlève toute raison.”
Frankl a offert un sens pour que l’homme puisse continuer.
U.G. enlève tout sens pour que l’homme cesse de continuer par peur.
L’un sauve la vie psychologique, l’autre la fait exploser.
L’un guérit l’esprit, l’autre le détruit.
7. Le point de rupture
Ce que Frankl appelle “victoire sur la mort”,
U.G. y verrait encore la main du mental — un triomphe imaginaire pour ne pas voir la simple évidence : il n’y a rien à vaincre.
La mort et la vie ne sont pas opposées.
Elles se produisent ensemble, à chaque instant.
8. Le sens est la maladie
La recherche de sens est la forme la plus raffinée de la peur.
Elle maintient en vie le “moi” qui veut durer.
Elle donne un vernis spirituel à la panique de disparaître.
Tant que tu veux comprendre, tu restes dans le temps.
Quand il n’y a plus rien à comprendre, le temps cesse.
Et là, sans effort, sans but, la vie se déploie — sans témoin.
Conclusion
“Tu leur donnes un sens pour supporter la vie, moi, je leur enlève tout sens pour qu’ils cessent enfin de la supporter.”
— U.G. Krishnamurti (réponse imaginaire à Viktor Frankl)