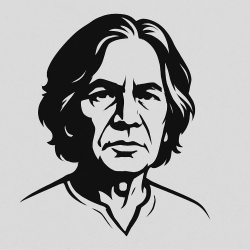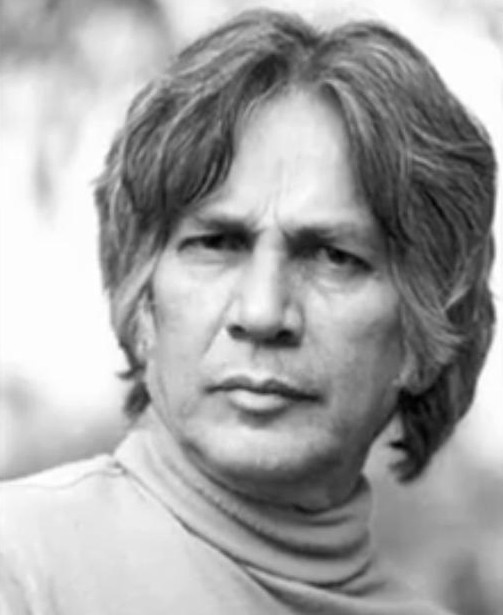
UG dit que la plupart des humains sont devenus névrosés parce qu’ils vivent dans ce décalage constant entre ce qu’ils sont (avec toutes leurs contradictions, leurs ombres, leurs parts « sombres ») et ce qu’ils devraient être selon des idéaux, morales, spiritualités ou attentes culturelles.
Cette tension crée une forme de souffrance intérieure : culpabilité, frustration, anxiété, sentiment d’insuffisance… qui sont, en psychologie, des manifestations courantes de névrose.
Mais ce n’est pas une « maladie » au sens médical ni une fatalité.
C’est surtout un constat :
- L’homme moderne est souvent enfermé dans un système de croyances et d’exigences qui lui demandent d’être autre chose que ce qu’il est.
- Cette déconnexion entre le vécu réel et l’image idéale crée un conflit intérieur.
UG invite à sortir de cette mécanique en cessant d’imposer ces idéaux artificiels, pour revenir à une acceptation brute et directe de ce qui est.
Donc, oui, dans ce sens, nous sommes tous un peu névrosés… mais c’est aussi la condition normale dans laquelle on évolue tant qu’on poursuit des idéaux extérieurs.
Et ce n’est pas figé : il est possible, par la prise de conscience radicale, de dépasser cette névrose, non pas en la combattant, mais en cessant d’alimenter ce conflit.
– Donc, si l’on analyse cette réponse avec l’approche psychanalytique, le « ça » est réprimé par le « surmoi » ?
Exactement, tu touches un point central en reliant la pensée d’U.G. Krishnamurti à la psychanalyse freudienne.
Dans le modèle freudien :
- Le ça représente les pulsions instinctives, les désirs bruts, les parts « primitives » de la psyché, souvent inconscientes.
- Le surmoi incarne la voix intérieure de la morale, des interdits, des normes sociales — c’est l’autorité qui impose ce que l’on « devrait être ».
- Le moi tente de gérer le conflit entre ces deux instances.
La « tension » dont parle U.G., entre ce que nous sommes (« méchant », c’est-à-dire notre « ça »), et ce que nous « devrions » être (gentillesse, compassion — la voix du « surmoi »), peut s’interpréter ainsi :
- Le surmoi réprime ou rejette le « ça », créant un conflit intérieur.
- Ce conflit est à l’origine de la névrose : la souffrance psychique, les culpabilités, les luttes internes.
U.G. met en lumière que cette répression (par le surmoi culturel, religieux, psychologique) est source de tension et de souffrance corporelle et mentale.
Mais là où U.G. va plus loin que la psychanalyse classique, c’est qu’il ne propose pas un compromis ou une intégration graduelle (comme le ferait le travail psychanalytique) mais plutôt un abandon radical du « devoir être », du surmoi imposé, pour permettre au corps et à l’esprit de se libérer de cette contrainte.
Cela rejoint, en quelque sorte, l’idée d’une désidentification totale avec ces injonctions morales, pour cesser la guerre intérieure.