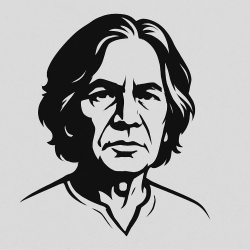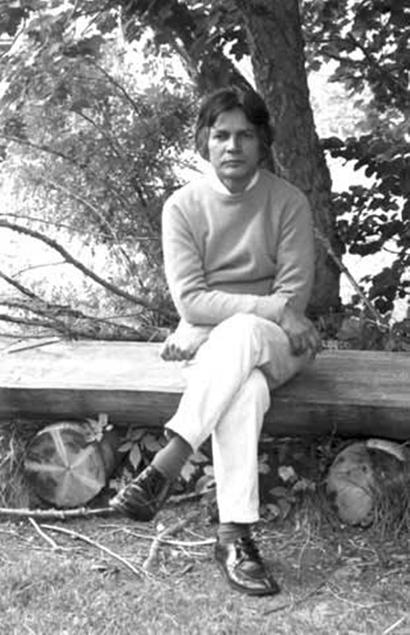
UG et certaines approches modernes de la thérapie convergent sur la nécessité d’arrêter la lutte intérieure.
Mais UG pousse le concept à son extrême en dénonçant la racine même du « devoir être » comme une source de souffrance.
C’est une invitation à une acceptation sans compromis, qui peut paraître brutale, mais qui ouvre un espace de liberté véritable.
U.G. Krishnamurti et l’ACT : accepter sans lutter
La thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) part du principe que la souffrance psychique naît souvent de la lutte contre nos pensées, émotions ou sensations désagréables.
Plutôt que de chercher à les contrôler ou à les supprimer, l’ACT invite à les accepter pleinement, sans jugement, et à s’engager dans des actions qui donnent du sens à notre vie, malgré la présence de cette souffrance.
La pensée d’U.G. Krishnamurti rejoint cette idée en affirmant que vouloir devenir « meilleur », plus « spirituel » ou plus « compatissant » est une forme de lutte inutile qui ajoute de la tension au corps et à l’esprit.
Au lieu de cela, il propose d’arrêter la course vers un idéal, de cesser la lutte contre ce que nous sommes déjà.
Ainsi, comme en ACT, il ne s’agit pas de nier la réalité ou de renoncer à agir, mais de changer notre relation à nos pensées et émotions, en cessant d’alimenter le conflit intérieur.
Cette approche radicale ouvre un espace de liberté où le corps et l’esprit peuvent fonctionner sans surcharge, permettant une forme d’acceptation authentique et profonde.
U.G. Krishnamurti et la théorie polyvagale : la fin de la tension intérieure
La théorie polyvagale, développée par Stephen Porges, met en lumière le rôle du système nerveux autonome dans nos réactions au stress et à la sécurité.
Elle explique que notre corps est constamment en quête de sécurité, et que face à une menace (réelle ou perçue), il active différentes réponses :
- mobilisation (combat/fuite),
- immobilisation (freeze),
- ou retour à un état de calme via la régulation vagale.
Le stress chronique, souvent lié à des conflits internes non résolus, maintient le corps dans un état de tension élevée, ce qui épuise le système nerveux et nuit à la santé globale.
Le texte d’U.G. Krishnamurti souligne que la lutte pour être ce que nous « devrions » être — guidée par des idéaux spirituels ou moraux — crée une tension et une surcharge pour le corps.
Cette tension peut être comprise, selon la théorie polyvagale, comme une activation constante des réponses de défense, empêchant la régulation et la sensation de sécurité intérieure.
Ainsi, en cessant cette lutte et en abandonnant les injonctions artificielles, on permet au système nerveux autonome de revenir à un état d’équilibre et de calme, favorisant la santé physique et mentale.
En ce sens, la pensée radicale d’U.G. rejoint la compréhension scientifique contemporaine de l’importance de la sécurité intérieure et de la co-régulation pour vivre sans tension ni névrose.
U.G. Krishnamurti et la Gestalt-thérapie : présence et acceptation de ce qui est
La Gestalt-thérapie met l’accent sur l’expérience ici et maintenant, invitant à être pleinement présent à ce que l’on vit, sans jugement ni tentative de fuir ou de modifier l’instant.
Elle valorise l’acceptation totale de soi, incluant ses parts lumineuses comme ses parts d’ombre, sans chercher à les refouler ou à les remplacer par un idéal.
U.G. Krishnamurti, dans sa pensée radicale, partage cette invitation à regarder la réalité sans voile ni artifice, en cessant de poursuivre des idéaux ou des normes imposées.
Son appel à cesser la lutte intérieure et à abandonner la pression du « devoir être » rejoint la démarche gestaltiste d’accueil de l’instant présent tel qu’il est.
Ainsi, la rencontre avec soi-même, dans la présence vraie et l’acceptation sans compromis, ouvre un espace de liberté où le corps et l’esprit ne sont plus contraints par des exigences extérieures, ni par des conflits internes.
U.G. Krishnamurti et la thérapie centrée sur la personne : authenticité et acceptation inconditionnelle
La thérapie centrée sur la personne, développée par Carl Rogers, repose sur trois piliers essentiels :
- l’acceptation inconditionnelle de soi, sans jugement ni conditions,
- la congruence, c’est-à-dire la sincérité et l’authenticité du thérapeute et du patient,
- et l’empathie, la capacité à se mettre à la place de l’autre.
Cette approche vise à permettre à la personne de se rencontrer telle qu’elle est, avec ses forces et ses vulnérabilités, sans chercher à répondre à des normes extérieures.
La pensée d’U.G. Krishnamurti rejoint cette idée d’une rencontre sans masque, où l’on cesse de vouloir devenir quelqu’un d’autre ou d’atteindre un idéal.
Son refus du « devoir être » et son invitation à vivre la réalité sans artifice résonnent avec la quête de Rogers pour une authenticité totale et une acceptation profonde de soi.
Ainsi, pour U.G. comme pour la thérapie centrée sur la personne, la liberté intérieure naît de la reconnaissance sans compromis de ce qui est, dans une relation vraie et sans condition.
U.G. Krishnamurti et la PNL : conscience des schémas et déconstruction
La PNL étudie les schémas mentaux, les filtres à travers lesquels nous percevons le monde, et propose des techniques pour changer nos représentations internes, afin d’agir autrement et de libérer des comportements limitants.
Elle met l’accent sur la conscience de nos « cartes mentales » et la possibilité de les modifier pour mieux s’adapter à la réalité.
U.G. Krishnamurti, dans sa pensée radicale, invite à aller au-delà de toutes ces constructions mentales — au-delà des cartes — pour voir la vie directement, sans les filtres d’idéaux ou de croyances imposées.
Son refus des « devoir être » et des idéaux correspond à une forme extrême de déconstruction des schémas mentaux.
Alors que la PNL propose souvent des techniques pour reprogrammer ces schémas, U.G. suggère plutôt de les abandonner totalement, en cessant toute quête de transformation fondée sur un futur idéal.
Ainsi, on peut voir la pensée d’U.G. comme un point d’ancrage ultime où toutes les reprogrammations cessent, laissant place à une conscience nue et immédiate.
U.G. Krishnamurti et la philosophie existentialiste : authenticité et liberté radicale
La philosophie existentialiste, portée par des penseurs comme Jean-Paul Sartre et Martin Heidegger, explore la condition humaine en insistant sur la liberté radicale de l’individu et sa responsabilité face à sa propre existence.
Elle met en lumière les mécanismes d’aliénation ou de « mauvaise foi », où l’individu se ment à lui-même pour éviter cette liberté, souvent par le biais de normes sociales ou de rôles imposés.
U.G. Krishnamurti partage cette préoccupation de l’authenticité, en dénonçant les constructions mentales, les idéaux spirituels ou moraux qui éloignent l’homme de sa vérité profonde.
Son appel à abandonner le « devoir être » et à cesser la lutte intérieure rejoint la quête existentialiste d’être soi-même, en refusant toute fuite dans des illusions ou des artifices.
Ainsi, U.G. offre une perspective radicale sur la liberté intérieure, invitant à une rencontre directe avec la réalité de l’instant, sans les filtres de la peur ou des conditionnements.